QUAND L'HISTOIRE NATURELLE SE PIQUE DE FANTAISIE, 3ème partie
Des reconstitutions fantaisistes, à l'origine de mythes ?
La reconnaissance progressive des fossiles en tant que véritables restes d’animaux à l’issue de longues tergiversations rapportées dans le chapitre précédent n’a pas empêché l’élaboration de reconstitutions pas toujours très rigoureuses desquelles le fabuleux n’était pas absent, celui-là se mêlant à une étude de la nature qui n’avait pas encore totalement établi ses fondements, de sorte que, comme il fut déjà évoqué en janvier 2023 dans la première partie de cette série d’articles consacrés à la Fantaisie en histoire naturelle, « récits fantasques de voyageurs et taxidermie douteuse », la science médiévale était empreinte d’éléments mythiques.
Il est fort possible que dans les époques reculées, les crânes d’éléphants nains qui vivaient sur les îles de Méditerranée comme la Sicile et Malte, probablement exterminés par les humains au début de la période historique, aient lors de leur découverte par les navigateurs suivants été interprétés comme ceux de cyclopes tel Polyphème dépeint par Homère dans L’Odyssée, le large orifice de l’insertion des muscles de la trompe évoquant une orbite unique, tandis que celles des yeux sont moins visibles et disposés latéralement.
Des squelettes de dragon faits de toutes pièces ?
Des hommes de science ont alimenté plus ou moins délibérément ces rapprochements avec des créatures mythiques pour entretenir la propension populaire au Merveilleux. Le crâne d’un rhinocéros laineux fut découvert à Klagenfurst en Autriche en 1335 sur un emplacement qui était réputé être l’ancien repaire d’un dragon. Le crâne fut considéré comme validant la réalité de l’existence de l’animal fabuleux dénommé "Lindorm" et en 1583 la municipalité fit ériger une fontaine surmontée d’une statue à l’image du monstre mythique, pourvu de deux ailes, pour commémorer la découverte, installation toujours en place.
Au XVIIème, les habitants de la périphérie de Rome se plaignaient de crues, qu’ils imputaient à des monstres serpentiformes tapis dans le fond des rivières. En 1696, un ingénieur hollandais du nom de Cornelius Meyer se proposa de remédier au problème, mais il ne pouvait trouver d’ouvriers, ceux-ci étant effrayés par des rumeurs récentes affirmant qu’un dragon des environs censé avoir été tué des années plus tôt était en réalité toujours en vie. Le maître d’œuvre répondit à leur angoisse en trouvant miraculeusement les restes du monstre, dont il présenta par la suite une gravure dans son ouvrage Nuovi ritrovamenti Divisi in Due Parti consacré aux travaux d’édification des digues. En 2013, des créationnistes se saisirent de cette histoire ancienne pour tenter de démontrer qu’un reptile volant qu’ils attribuaient à l’espèce Scaphogathus crassirostris vivait encore au Moyen Âge, dans l’intention de contester la géochronologie admise et de valider à l’inverse leur vision d’une Histoire de la Terre bien plus brève en accord avec leur conception littérale de la Bible niant le processus d’évolution. Cette controverse amena deux auteurs, Phil Senter et Pondanesa D. Wilkins, à examiner de plus près la gravure du monstre de Meyer, établissant que le crâne figuré était celui d’un chien, la mandibule d’un second plus petit, la cage thoracique provenait d’un grand poisson, les vertèbres thoraciques d’un castor et les pattes d’un jeune ours, tandis que le bec, les cornes, les ailes et la queue étaient de pures fabrications, l’ensemble ayant été en partie recouvert d’une fausse peau. Le dragon malicieusement agencé par Cornelius Meyer ressemble étonnamment à celui nommé Dracunculus Monoceros qui figure dans un ouvrage de 1651 consacré à la nature mexicaine par Francesco Stelluti, réalisé un siècle après l’expédition de Francisco Hernandez d’après ses notes, Nova plantarum, animalium et mineralium Mexicanorium historia, à la différence qu’il possède une corne au lieu de deux, à tel point qu’on peut se demander si le prétendu découvreur n’en a pas eu connaissance et ne s’en est pas inspiré.
Un autre reste de rhinocéros laineux fut découvert en 1663 en Allemagne, dans une grotte située à proximité de Quedlinburg, obtenant une certaine renommée. Le scientifique prussien Otto von Guericke, créateur de la pompe à vide, postula que les vestiges de l’animal comportant un crâne, une corne, des côtes, des vertèbres dorsales et des os, étaient ceux d’une licorne. Après une illustration publiée en 1714 par le médecin Michael Bernhard Valentini basée sur les dessins de von Guericke, laquelle reproduit bien la forme du crâne d’un rhinocéros au-dessus du reste du squelette, le fossile fut à nouveau représenté en 1749 avec la même allure générale dans le traité posthume de géologie et d’histoire naturelle Protogaea du célèbre mathématicien et philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz qui estima que l’être était comme la licorne une véritable chimère en laquelle on pouvait reconnaître les parties de différents animaux. L’auteur justifia sa nature singulière en établissant un parallèle avec les expériences de laboratoire réalisées dans les éprouvettes, postulant que la nature expérimentait de la même manière en utilisant les volcans comme des fourneaux pour y façonner des œuvres merveilleuses – rappelons que la théorie de l’évolution n’avait pas alors été formulée. Liebniz ajoute que cette créature était marine en l’identifiant au narval à l’allure pourtant bien différente, ce cétacé dont le mâle est pourvu d’une très longue défense torsadée.
L’illustration qu’avait fait paraître Leibniz servit de base au montage du squelette incomplet au Muséum d’histoire naturelle de Magdeburg, avec ses deux grosses pattes et son dos en pente raide surmonté d’une tête cornue, donnant l’impression d’une créature tronquée. La reconstitution finit par perdre toute crédibilité, mais en 2018, le spécimen fut utilisé pour un poisson d’avril initié par le bureau de l’État de Saxe-Anhalt en charge de la préservation des monuments historiques et de l’archéologie, qui annonça qu’une analyse génétique l’avait identifié comme appartenant à une espèce éteinte d’ongulé du Pléistocène nommée Monoceros mendaciloquus, dont les derniers représentants se seraient éteints à la fin du Moyen Âge, mais très peu de représentants du monde scientifique accordèrent crédit au canular. Une étude récente conduite par un professeur de l’université de Leiden, Thijs van Kolfschoten, redonne quelque crédit à l’interprétation de Leibniz du squelette en tant que chimère, mais naturellement constituée artificiellement par l’assemblage de pièces hétéroclites, celui-ci postulant effectivement que si le crâne est bien celui d’un rhinocéros laineux, la corne pourrait être une défense de narval, les deux membres et les clavicules appartiennent à un mammouth laineux tandis que le reste des ossements pourraient être issus d’une autre espèce toujours non identifiée.
En 1613, un chirurgien de Beaurepaire, Mazuyer, déclara avoir découvert les reliques d’un Géant, son assertion notamment confortée par un notaire, ce qui fut dénoncé comme une supercherie par son confrère Jean Riolan. En 1676, le naturaliste britannique Robert Plot découvrit probablement le premier vestige de dinosaure, un fémur du carnivore Megalosaurus, qu’il interpréta comme un fragment d’os de géant. Au siècle suivant, le médecin Richard Brookes se montra dubitatif en regardant le dessin que Plot en avait tiré et l’envisageant à l’aune de sa propre spécialité, le nomma Scrotum humanum en l’assimilant à une partie de l’appareil génital masculin auquel sa forme lui faisait songer. À la même époque, un forain présentait à travers la France une caisse contenant des ossements comme étant ceux du géant Theutobocus, roi des Teutons (en fait un Cimbre du 2ème siècle réputé de grande taille) tué par le Romain Marius à la bataille d’Aix-en-Provence. Le paléontologue Léonard Ginsburg identifia en 1984 à Paris une dent du Géant comme étant celle d’un Deinotherium, un parent de l’éléphant représentant un des plus grands mammifère terrestres jamais découverts.
L’imprégnation des textes bibliques, considérés comme l’expression intangible de la vérité révélée, était encore si marquée chez les naturalistes du XVIIIème siècle que le savant suisse Johann Jacob Scheuchzer, qui après avoir cru que les fossiles se formaient dans la terre sous l’action d’un "suc lapidescent" s’était rangé à l’opinion de John Woodward dont il a diffusé l’œuvre selon laquelle il s’agit d’anciens organismes vivants, fut persuadé d’avoir trouvé à travers une partie de squelette les restes d’un homme noyé au cours du Déluge. Celui-là consistait en un crâne semi-circulaire et en une partie du squelette portant deux membres antérieurs terminés par des doigts. Dans son livre de 1726 intitulé Lithographia Helvitica, il appelle le fossile Homo diluvi ("l’Homme du Déluge"). Le célèbre Cuvier se rendit en 1812 au musée néerlandais de Haarlem qui l’avait acquis dix ans plus tôt, et en dépit de son adhésion à leur vision commune du Déluge, le paléontologue français établit qu’il ne s’apparentait pas à l’espèce humaine. Un fossile plus complet du même animal aurait permis à Scheuchzer de visualiser les deux pattes postérieures indiquant plus ouvertement qu’il s’agissait d’un être quadrupède ainsi que le prolongement de la colonne vertébrale sous la forme d’une queue. En 1831, ses affinités reconnues avec les Batraciens lui valurent d’être renommé Salamandra scheuchzeri, le nom d’espèce conservant le souvenir de son descripteur initial. L’animal fut associé aux grandes salamandres de Chine et du Japon, les plus grands amphibiens actuels qui atteignent près d’un mètre de long au sein de la famille des Cryptobranchidés, dans un genre nouvellement créé en 1837, Andrias, en tant qu’Andrias scheuchzeri – ce terme issu du grec andros, l’homme, conserve ainsi à jamais accolée au nom du savant suisse son interprétation anthropomorphe du fossile.
La découverte en 1799 du premier squelette de Mastodonte (Mammut americanum), un contemporain des mammouths également couvert de longs poils mais à la silhouette plus allongée avec lesquels il fut à l’époque confondu, puis sa présentation dans le musée de Philadelphie en 1806, avait fait sensation, amenant nombre de visiteurs prêts à débourser 50 cents supplémentaires pour pouvoir l’apercevoir dans le musée de Charles Peasle. Cette présentation lucrative incita Albert C. Koch, passionné par les fossiles, à ouvrir en 1836 un cabinet de curiosité comportant notamment des artefacts amérindiens et un reste de paresseux géant du genre Mylodon – ainsi que des ventriloques et des magiciens, les bénéfices lui permettant d’organiser des chantiers de fouilles, et à y présenter cinq ans plus tard un squelette de mastodonte deux fois plus grand que celui de Philadelphie. Averti en mars 1840 qu’un fermier avait trouvé dans le Missouri des restes d’un énorme animal, il se rendit sur place aussitôt en dépit d’une fièvre passagère et après avoir dirigé pendant quatre mois des travaux d’excavation, il revint à son musée avec un squelette de près de dix mètres de long et d’une hauteur de 4,50 mètres, soit le double d’un mastodonte véritable, muni d’une colossale paire de défenses, et il le présenta sous le nom de Missourium comme le "Léviathan du Missouri" en prétendant qu’il n’était autre que l’animal fabuleux cité dans le Livre de Job de l’Ancien Testament. Il s’agissait bien en réalité de restes de mastodonte, mais Koch avait additionné les ossements de plusieurs individus et encore accru la taille de la colonne vertébrale en y intercalant discrètement des pièces de bois. Il orienta aussi les épaules et le bassin de sorte de faire paraître encore plus grand le résultat, de même qu’il érigea les défenses sur les côtés et au-dessus du crâne au lieu de les positionner en avant et vers le bas telles qu’elles étaient orientées, de manière à rendre encore plus spectaculaire la présentation.
Dans son petit livret, Description of the Missourium, Albert Koch évoqua de manière fantaisiste l’animal, prenant des libertés avec les caractéristiques du squelette en dépeignant son Léviathan biblique comme un reptile aquatique aux pieds palmés et en suggérant qu’il devait être recouvert d’écailles « comme l’alligator ou peut-être le Megatherium » – à l’époque, on prêtait parfois une carapace aux paresseux géants en les rapprochant de leurs lointains parents les tatous. Après avoir vendu son musée en 1841, Koch fit une tournée européenne avec son spécimen à la manière de Barnum ; le célèbre paléontologiste britannique Richard Owen ("le Cuvier anglais") l’acquit en 1843 pour 1300 £ ainsi que le versement d’une rente annuelle de 650 $, et le fit remonter tel qu’était véritablement le squelette d’un mastodonte afin de le présenter au Muséum d’Histoire naturelle de Londres. Aucun paléontologiste sérieux n’a jamais adhéré à l’interprétation du "Léviathan reptilien" qui n’a existé qu’au travers de l’assemblage fallacieux de Koch. Par ailleurs, aucun mammifère d’une taille aussi considérable ayant vécu sur la terre ferme n’avait alors été découvert tel que le figurait le squelette retouché ; cependant, on découvrit en 1788 le reste du plus grand paresseux terrestre, le Megatherium précité pouvant atteindre 6 mètres de haut dressé, et un mammifère terrestre ongulé réellement gigantesque sera exhumé au début du XXème siècle, un énorme rhinocéros primitif sans corne qui vivait en Asie à l’époque où la végétation était plus abondante, le Baluchitherium (parfois assimilé au genre Paraceratherium dans les taxonomies récentes).
Le passionné de fossiles, qui se faisait appeler Docteur, se fit une spécialité de présenter des squelettes d’animaux disparus rendus encore plus spectaculaires qu’ils étaient, puisqu’en 1845 il exhiba un nouveau squelette de "Léviathan reptilien", cette fois découvert en Alabama, qui avait tout du mythique Serpent de mer et qu’il baptisa Hydrarchos. Cet animal marin était censé surveiller ses proies en redressant un cou de cygne et porter des nageoires. L’animal mesurait plus de 34 mètres de long et 9 mètres de diamètre de son vivant selon l’auteur dans le fascicule qu’il lui avait consacré, Description of the Hydrarchos harlani – le nom d’espèce fut forgé d’après celui du paléontologue décédé Harlan qui avait découvert le premier Basilosaurus, un cétacé disparu, après qu’un autre naturaliste, Benjamin Silliman, qui croyait à l’existence des grands serpents de mer et avait authentifié dans un article public le squelette de Koch, lui avait demandé de ne plus l’associer à son nom une fois la fraude avérée, notamment dévoilée par le paléontologue anglais Gideon A. Mantell. En dépit de son allure serpentiforme ainsi que de l’existence de reptiles marins géants contemporains des dinosaures, la nature mammalienne du squelette était manifeste en raison de la double racine des dents que Koch lui-même avait relevée, identiques à celles d’un grand cétacé carnassier, le Basilosaurus précité ou Zeuglodon. Par ailleurs, comme pour le Missourium, la colonne vertébrale du monstre était constituée à partir de celles de plusieurs individus, peut-être six au total, aboutissant à une taille plus longue de deux tiers que le véritable animal. Entre-temps, Koch avait vendu son squelette au Roi de Prusse Frédéric Guillaume IV pour une rente annuelle. Le spécimen fut finalement confié à Johannes Müller du Musée royal d’anatomie de Berlin et connut le même sort que le Missourium, étant déconstruit pour que sa nature authentique de Basilosaurus lui soit rendue. Koch quant à lui ne se démontait pas si on peut dire, il entra en 1848 en possession d’un second squelette de Basilosaurus qu’il transforma à nouveau pour en faire un autre Hydrarchos un peu plus petit et reprendre une tournée en Europe, avant de le vendre au musée de St Louis, lequel le céda finalement au musée de Chicago qui devait disparaître dans le grand incendie qui embrasa la ville en 1871.
Les présentations du Dr Koch furent dénoncées comme frauduleuses par la majorité des spécialistes anglo-saxons de sorte qu’à sa mort en 1867, il avait perdu tout crédit ; ses collaborateurs sur les chantiers reconnurent eux-mêmes que, contrairement à ses affirmations selon lesquelles il avait découvert les fossiles en l’état, les fouilles avaient exhumé de nombreuses pièces éparses, parfois sur une grande superficie. Les paléontologues allemands se montrèrent cependant plus indulgents en estimant que ce passionné de fossiles qui, comme Barnum, était avant tout un entrepreneur de spectacles, avait permis de conduire de nombreuses fouilles et que, bien que dépourvu de la rigueur de leur discipline, il avait tenté de reconstituer comme il l’avait pu ses spécimens, arguant que le très réputé Georges Cuvier avait lui-même éprouvé la nécessité de reconstituer des animaux disparus en assemblant des éléments provenant de plusieurs individus afin de pouvoir obtenir des squelettes complets. Son affirmation selon laquelle les mastodontes et les paresseux géants avaient été contemporains des Paléoindiens a quant à elle été confirmée, même si les pointes de flèches associées aux squelettes des animaux disposées par le décidément incorrigible Albert Koch étaient on ne peut plus récentes et vraisemblablement façonnées dans les réserves indiennes pour être vendues aux touristes.
Après les fossiles façonnés par des faussaires, squelettes de supposés chimère, dragons, licornes et Léviathans bibliques, on ne peut refermer, au moins provisoirement, cette série sur les faux en paléontologie des époques passées, qu’avec le crâne attribué à un de nos ancêtres, celui de L’Homme de Piltdown, la plus célèbre imposture de l’histoire de l’étude des fossiles. En 1912, l’archéologue amateur et collectionneur d’antiquités Charles Dawson prétendit que son équipe avait découvert en Angleterre des restes d’hommes de la Préhistoire, étudiés par Smith Woodward qui nomma le fossile Eoanthropus dawsoni ("L’homme de l’aube de Dawson"). Le spécimen avait tout d’une forme transitionnelle espérée par les évolutionnistes, avec son crâne bien développé, moderne, et sa lourde mandibule simiesque. Les méthodes de datation des années 1950 confirmèrent finalement les soupçons de ceux qui mettaient en cause l’authenticité et l’ancienneté de L’Homme de Piltdown. Le crâne s’avéra être celui d’un homme du Moyen Âge, la mandibule celle d’un orang-outan et les dents appartenir à un chimpanzé, l’ensemble ayant été vieilli artificiellement pour faire passer l’assemblage pour un fossile remontant au Pléistocène. Les hominidés de la Préhistoire semblent n’avoir en réalité véritablement accru leur volume crânien que lorsque la mâchoire s’est réduite du fait de l’invention du feu pour cuire les aliments et des outils qui rendaient la mastication plus aisée. Aucun fossile d’Eoanthropus n’a été découvert après le décès de Dawson en 1916 et l’antiquaire s’était déjà signalé pour avoir commis 38 faux en matière d’antiquité, sans parler d’une côte de mammouth, authentifiée par Smith Woodward, qui avait été travaillée de manière à être présentée comme une batte de cricket prêtée à l’homme fossile…
Les créationnistes se délecteront de cette supercherie en faisant valoir que le fossile vivant le plus crucial, permettant de rattacher l’espèce humaine à la lignée des grands singes, était une falsification destinée à faire accroire l’existence d’un chaînon manquant déniant à notre espèce sa spécificité et son origine divine. Les doutes déjà exprimés à l’époque sur l’authenticité de la découverte ne pouvaient qu’alimenter la suspicion à l’encontre de la sincérité des évolutionnistes telle qu’elle s’exprima lors du célèbre "Procès du singe" qui se tiendra aux États-Unis à Dayton en 1925, lorsque des chrétiens fondamentalistes s’opposèrent à l’enseignement de la théorie de l’évolution en affirmant que celui-ci violait leur droit de voir assurés à leurs enfants des cours qui ne soient pas en contradiction avec leur vision littérale de la Bible à laquelle sont attachées un certain nombre de confessions protestantes et que défendent encore aujourd’hui un nombre non négligeable d’élus du Parti républicain. Lors du procès, des évolutionnistes avaient d’ailleurs évoqué la découverte de la dent d’un homme fossile dans un gisement du Nebraska datant du Pliocène, un reste en mauvais état qui se révélera finalement en 1927 appartenir à une espèce éteinte de pécari – ces suidés vivaient initialement en Amérique du Nord avant de s’établir en Amérique du Sud quand les deux continents furent reliés).
Une autre confusion se produisit lorsque le paléoanthropologue roumain Contantin S. Nicholaescu-Plopsor déclara avoir découvert dans la région d’Olténie les ossements fossiles d’une variété d’Homo habilis. Ceux-ci, consistant en deux fémurs et un tibia, furent présentés lors de la session scientifique du Centre des sciences sociales de Craiova le 21 février 1981, puis à l’occasion d’une conférence de presse le 13 mars 1981, comme étant les restes du plus ancien homme d’Europe remontant à 2 millions d’années et rebaptisé Australoanthropus olteniensis. Le chercheur belge Jean-Marie Cordy a en 1993 considéré que ces ossements étaient ceux d’un ours.
Une nouvelle accusation quant aux « manipulations auxquelles recourent les évolutionnistes » aura lieu plus tard avec un peu moins de retentissement médiatique lorsque des paléontologues, trop heureux de commencer à découvrir enfin des fossiles de formes ancestrales de cétacés, proposeront trop hâtivement une reconstitution complète du Pakicetus, figuré comme présentant les caractéristiques d’un être amphibie, alors qu’il est apparu par la suite qu’il avait une allure traduisant l’agilité d’un petit animal terrestre – c’est en réalité son descendant l’Ambulocetus (étymologiquement "la baleine qui marche") dont la morphologie traduit une adaptation manifeste à la vie aquatique. Les créationnistes verront dans l’empressement des paléontologues à reconstituer cette étape évolutive, en spéculant à partir d’une simple portion de crâne au travers de laquelle le Pakicetus était initialement connu, la preuve d’une instrumentalisation des fossiles de manière à démontrer fallacieusement la transformation des espèces au cours du temps.
En passant en revue les siècles au cours de ces deux derniers articles pour examiner de quelle manière la fantaisie a pu se mêler à l’interprétation des fossiles, nous sommes parvenus jusqu’au tout début du XXème siècle – même si certains historiens considèrent que celui-ci ne commence réellement qu’en 1914. Pour autant, il ne s’agit là nullement du terme de notre voyage dans la science facétieuse. La Révolution industrielle qui au cours du XIXème siècle augure le cadre de nos sociétés modernes n’a pas nécessairement mis un terme à une approche débridée des sciences naturelles alors qu’on les pratique ordinairement avec un esprit de sérieux qui paraît empreint d’austérité, encore accru par l’environnement technique au travers d’appareils de plongée et de microscopes toujours plus sophistiqués qui étendent les champs de découverte. Nous verrons dans la suite de cette série sur la fantaisie en histoire naturelle que la séquence réserve encore quelques épisodes singuliers dans une époque qui paraît avoir banni l’approximation dans le domaine de la connaissance.
- - - - -
La reconstitution du "Missourium" par Tim Morris vient de cet article du cryptozoologue Karl Shuker :
http://karlshuker.blogspot.com/2021/07/kochs-monstrous-missourium-and-horrid.html
Karl Shuker a également traité en détail du second montage élaboré par Albert C. Koch : http://karlshuker.blogspot.com/2021/07/kochs-monstrous-missourium-and-horrid_24.html
* * *
PROCHAIN VOLET : Lorsque la presse à sensation s'empare de la science
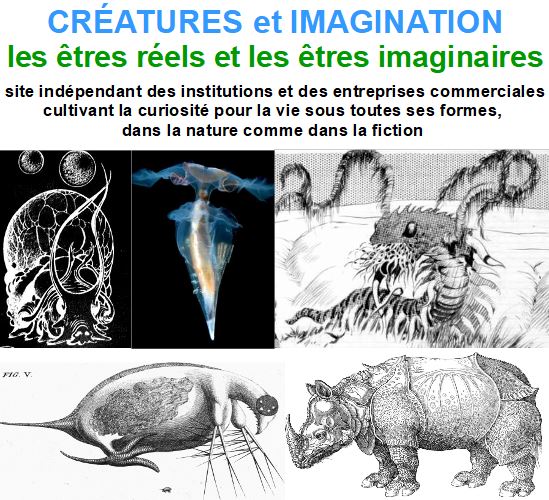




.webp)

_Hydraulic_Engineer_recadr%C3%A9.jpg)






















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire