QUAND L'HISTOIRE NATURELLE SE PIQUE DE FANTAISIE, 2ème partie
Les fossiles ont longtemps défié les interprétations des érudits.
En février 2023 a été présenté ici le début d'une série d'articles retraçant comment, au travers des époques, l'Histoire naturelle a pu être mêlée à des interprétations fantastiques, un sujet qui s'impose naturellement sur ce site qui orchestre fréquemment au travers du thème des créatures l'évocation croisée et même la rencontre entre les aspects les plus étonnants du monde vivant et son prolongement au travers de l'imaginaire, depuis les anciens mythes et légendes jusqu'à la science-fiction. Cette série de sept articles a été rapidement interrompue par diverses actualités, notamment suite à des découvertes scientifiques et à des disparitions de personnalités en rapport avec les créatures imaginaires.
Il est donc temps à présent de reprendre le fil de cette saga historique. La première partie a évoqué comment de l'Antiquité romaine à la Renaissance, les naturalistes soucieux d'être exhaustifs ont compilé dans leurs traités des erreurs d'observation et même des affabulations des voyageurs, jusqu'à parfois y inclure des êtres mythiques, et comment certains ont profité de la crédulité de ces auteurs pour concevoir délibérément des faux jusqu'à faire douter de l'existence d'un animal réel. Dans cette deuxième partie, on va délaisser les créatures vivantes autant que les êtres légendaires pour s'intéresser aux restes d'organismes conservés dans les couches géologiques et à l'énigme que cela a représenté au cours des âges pour certains de nos ancêtres.
Des prototypes du vivant dans la pierre ?
L'effrayant Maître des gnomes dans le film Oz, un monde extraordinaire (Return to Oz), une production Disney librement inspirée de l'œuvre de Frank L. Baum ; si ce personnage sous forme de rocher humanoïde dont on peut trouver quelque équivalent dans les péplums appartient incontestablement au domaine du Merveilleux, il n'aurait peut-être pas été estimé si fantaisiste dans les temps anciens lorsque nombre d'érudits étaient persuadés qu'au travers de processus géochimiques ou thermodynamiques la vie animale pouvait se former au sein du monde minéral, comme le déplorait le naturaliste suisse Johann Jakob Scheuchzer : "On adjuge au règne minéral ce qui appartient au règne végétal, ou à l'animal, de sorte qu'il étend ses limites plus loin qu'il n'est équitable."
Pour le lecteur contemporain, il n’est pas douteux que les formes minéralisées telles que les coquillages et oursins qu’on trouve dans la pierre sont des restes d’animaux d’époques reculées. Au cours de l’Histoire, bien des esprits brillants se sont interrogés devant ce qui nous apparaît de nos jours comme une évidence, jusqu’à ce que la notion de fossile s’impose tardivement. Dans ce deuxième volet de la série d’articles consacrée à l’Histoire naturelle fantaisiste qui correspond particulièrement bien à la thématique de ce site qui fait se rencontrer la nature réelle dans toute son étrangeté et son accaparement par l’imaginaire, on se propose de retracer pour le lecteur ce cheminement laborieux au travers des croyances jusqu’à l’orée de la science paléontologique.
Dans l’Antiquité, des présocratiques comme le savant Thalès, le philosophe Xénophane de Colophon, le conteur Hérodote, puis un peu plus tard l’historien Xanthos de Lydie, le savant Eratosthène ou encore le géographe Strabon envisageaient les fossiles inclus dans les roches en tant que vestiges d’animaux marins portant témoignage de l’existence d’une mer depuis longtemps asséchée ; au XII ème siècle, le Chinois Chu Hsi inclinait aussi à penser qu’il s’agissait d’animaux qui s’étaient solidifiés après avoir été remontés des profondeurs. Cependant, l’opinion longtemps la plus répandue, qui perdurait encore au temps de la Renaissance, avançait des explications plus insolites, postulant que ces pierres singulières étaient tombées du ciel, avaient été créées par la foudre ou bien avaient été formées spontanément dans le sous-sol ou dans les mers par un phénomène que Théophraste nommait "vis plastica", lequel reproduisait partiellement la forme d’êtres vivants par le jeu du hasard.
Ces derniers pouvaient d’ailleurs eux-mêmes être générés dans certaines conditions à partir de matière inerte selon la théorie de la génération spontanée s’enracinant dans la philosophie grecque la plus ancienne depuis Anaximandre et reprise par le médecin et philosophe des X-XIèmes siècles Avicenne, toujours présente dans les esprits au XIXème siècle – la pérennité de cette représentation sera évoquée à de futures occasions. Même Aristote, auquel on a fait une allusion élogieuse dans la première partie de cette série d’articles, rejetait ce qui nous paraît dorénavant une évidence, en assurant que ces manifestations géologiques procèdent principalement de l’action de la chaleur et du froid s’exerçant dans le substrat, ou dans certains cas que des graines à l’origine d’animaux marins pouvaient tomber du ciel et se perdre dans le sol en donnant ces formes similaires à des organismes latents attendant de prendre vie – il avait vu plus juste en supputant que la Terre était autrefois entièrement recouverte par un océan. Ces conceptions peuvent aujourd’hui nous paraître de nature magique, mais il est vrai que la théorie de l’évolution avait alors été à peine pressentie par quelques présocratiques, et qu’aussi incongrue que semble être à présent la conception d’organismes complexes se formant spontanément sous certaines conditions, elle procède pour le naturaliste grec du souhait de trouver des causes naturelles susceptibles d’expliquer la génération d’organismes dans les cas les plus énigmatiques.
Au XIIIème siècle, un des premiers grands naturalistes et également théologien, Albert le Grand, conciliait les deux explications antagonistes ; dans De Mineralibus, il explique que les fossiles peuvent représenter de vrais animaux dont les composants naturels ont été minéralisés, entraînant leur pétrification, mais précise aussi que lors de la formation d’une roche, le mouvement giratoire d’une vapeur demeurant captive en son sein serait susceptible de créer une forme similaire à celle d’un coquillage en attente d’un esprit vital pour l’animer selon le principe vitaliste d’Aristote, et en accord avec la théorie de la génération spontanée de la vie de son inspirateur Avicenne – lequel considérait par contre à la différence du savant grec de l’Antiquité que les fossiles se formaient par un fluide pétrifiant plutôt que par l’exhalaison de vapeurs, même s’il semble par ailleurs avoir établi une corrélation entre des fossiles d’animaux marins et la présence d’anciennes mers à l’endroit où on les a découverts, autre indication que ces différentes conceptions étaient alors estimées compatibles.
Au XVI siècle, l’archéologue allemand Georg Bauer dit Agricola porta également son attention sur les restes préservés d’animaux avec son ouvrage de géologie De Natura fossilium paru en 1456 qui propose une typologie des matériaux extraits du sol (les fossiles dans l’acception large de l’époque), incluant les traces de la vie passée. L’auteur envisage la nature animale originelle de certains de ces objets tels les corps de petits animaux préservés dans la résine de même que des coquillages et des coquilles d’ammonite, un type de céphalopode éteint à la fin de l’ère mésozoïque en même temps que les derniers dinosaures, sans pour autant exclure qu’ils soient façonnés au sein du substrat ; quant aux fossiles d’oursins, il considère conformément à la vision de l’époque qu’il s’agit de pierres tombées du ciel.
Le célèbre naturaliste suisse Conrad Gesner fait à son tour paraître juste avant de décéder en 1516 un livre sur le sujet en complément de ses autres publications traitant d’histoire naturelle, De rerum fossilium, lapidum et gemmarum maximé. L’ouvrage présente avec une grande exactitude des illustrations de nombre de fossiles d’animaux, coquilles de bivalves, de gastéropodes, d’ammonites et de bélemnites (d’autres céphalopodes éteints apparentés aux seiches dont subsiste l’os interne), de crabe, d’oursins, de sections étoilées de tiges de crinoïdes qu’avait déjà évoquées Agricola et de dents de requins. L’interprétation que propose le savant de certaines de ces découvertes peut parfois sembler quelque peu approximative. Une dent de requin est identifiée comme étant le bec d’un merle alors même qu’il relève que sa partie inférieure évoque les racines d’une dent. Quant aux ammonites, s’il en rapproche des escargots certaines auxquels on pouvait effectivement les assimiler par analogie tant qu’on ne disposait pas d’informations sur l’animal qui occupait la coquille, une autre avec un long enroulement au diamètre plus constant est comparée à un serpent lové sur lui-même dont il prétend voir une tête bien inexistante. En dépit des nombreuses corrélations établies dans son traité par Conrad Gesner entre ces fossiles et des espèces animales, le naturaliste demeure assez évasif quant à la nature et à la formation de ces pièces remarquables.
"Etoiles tombées du ciel" : il s'agit en réalité d'encrines, des tronçons détachés du pédoncule de crinoïdes fossiles, des animaux fixés des profondeurs qu'on surnomme "lys de mer", dont on peut voir au second plan un tronçon plus complet.
L’impossibilité générale de considérer les "pierres figuratives" en tant que restes de plantes ou d’animaux était si fortement ancrée dans les esprits en ces temps-là qu’un marchand ambulant de Westphalie qui contre quelques pièces montraient des spécimens de poissons pris dans des grès de la période crétacée fut en 1550 brièvement incarcéré dans la ville de Kampen aux Pays-Bas en tant que faussaire présumé, personne ne voulant croire que la roche puisse naturellement contenir de telles pièces rappelant autant de véritables poissons, avant qu’un juge plus conciliant ne le fasse libérer et expulser avec la boîte renfermant sa collection.
Dans les temps anciens, les fossiles faisaient objet de nombre d'interprétations souvent extravagantes, même chez les savants ; au Moyen-âge, des fossiles comme celui de ce coquillage (Proschizophoria, un bivalve n'appartenant pas aux mollusques mais au groupe de Brachiopodes procédant d'une évolution convergente) ont pu être interprétés par les croyances populaires comme la marque dans des rocs de montagne de l'empreinte d'un sabot du Diable, classiquement représenté dans la lignée du Dieu Pan avec des pieds de bouc.
Le célèbre médecin français Ambroise Paré, qui a, il est vrai, donné dans son ouvrage "Des monstres et prodiges" un apparent crédit à l'existence de nombreux êtres fabuleux à la suite des naturalistes médiévaux, alimente au XVIème siècle la croyance selon laquelle des animaux pourraient naître de la pierre ou au moins s'y trouver contenus à l'état vivant, en relatant la découverte à Meudon d'un « gros crapaud vif » contenu dans une pierre volumineuse, en précisant que selon le carrier, trouver différentes sortes d'animaux vivants dans des pierres n'est pas si rare. Il conclut : "On peut aussi donner raison de la naissance et vie de ces animaux : c’est qu’ils sont engendrés de quelque substance humide des pierres, laquelle humidité putréfiée produit telles bêtes." Le cryptozoologue (spécialiste des animaux mystérieux) Jean-Jacques Barloy indique dans son article "Rumeurs sur des animaux mystérieux" (accessible en ligne) qu'en 1851 encore, on aurait rapporté qu'un crapaud vivant avait été sorti d'un nodule de silex.
L'émergence d'une meilleure compréhension des fossiles
Ce sont deux artistes qui vont le plus clairement postuler que ces ressemblances ne sont en rien fortuites et qu’elles procèdent bien de la conservation de restes d’organismes réels. En 1590, Bernard Palissy écrit dans son Livre des pierres que les coquillages trouvés dans les sites fossilifères sont ce qu’il subsiste d’êtres aquatiques qui ont été pétrifiés au cours d’un processus naturel, retrouvant la logique de présocratiques cités au début de l’article. Léonard de Vinci évoque même dans ses carnets personnels les dépôts de boue charriée par les courants, emprisonnant des animaux et se changeant en pierre en gardant ainsi la trace de ces organismes ; c’est très exactement la façon par laquelle les gisements appelés "laggerstatten" ont préservé des créatures dépourvues de parties dures jusqu’à des méduses et à leurs tentacules si délicats, permettant notamment de découvrir nombre de formes anciennes qui seraient autrement demeurées à jamais inconnues comme la faune édiacarienne du Précambrien terminal appelé Protérozoïque et celle du début du Cambrien dite faune de Burgess Shale, au-delà des trilobites bien connus recouverts d’une carapace qui commençaient déjà à prospérer à l’époque. L’artiste italien de la Renaissance établit avec d’autant plus de certitude le lien entre de véritables animaux et leur préservation minéralisée qu’il note sur les fossiles les mêmes marques de développement que chez les premiers : « D’autres personnes non instruites déclarent que la Nature, ou le Ciel, les ont créées sur place par des influences célestes, comme si en ces mêmes lieux on n’avait pas également trouvé des os de Poissons ayant mis longtemps à croître, et comme si nous n’étions à même de mesurer sur les coquilles des clovisses [palourdes] et des escargots leurs périodes de croissance, comme on le fait sur les cornes des taureaux et des bœufs ».
Leonard de Vinci, un de ses croquis de fossiles (la flèche pointant une apparente colonie de bryozoaires) et en dessous Bernard Palissy.
L’idée de la vraie nature des fossiles commence à leur suite à se frayer un chemin chez les scientifiques. En 1616, le botaniste italien Fabio Colonna établit dans son ouvrage De glossopteris dissertatio que les glossoptères, ces "pierres de langue" trouvés dans les roches, que Pline l’Ancien croyait tombées du ciel ou de la Lune ou qu’on disait aussi parfois se former spontanément dans les roches, sont véritablement des dents de requin. L’évêque, anatomiste et géologue danois Niels Stensen approuva cette interprétation en précisant en 1667 qu’il existait une substitution au niveau de la composition, postulant ainsi le processus de minéralisation. Le savant anglais Robert Hooke, un des premiers à fabriquer des microscopes, et à ce titre requis pour valider la découverte pour la première fois d’organismes invisibles à l’œil nu par Anton Leeuwenhoeck, a observé en 1665 des coupes de bois pétrifié et en a conclu qu’il s’agissait bien d’authentiques fragments d’arbres anciens, en déduisant que les fossiles consistaient en les restes d’organismes vivants, tels les coquilles d’espèces marines trouvées en altitude suite aux soulèvements de terrains, incluant des formes depuis éteintes.
Les dents fossilisées de requin ont été l'objet de bien des interprétations les plus fantaisistes jusqu'à être enfin reconnues pour ce qu'elles sont.
Pourtant, au XVIIème, un naturaliste réputé tel que John Ray, connu notamment en zoologie pour ses traités sur les poissons comme pour les reptiles, et qui admettait la transformation des espèces au nom d’un créationnisme continu, ne parvenait toujours pas à admettre que des fossiles comme les Ammonites puissent représenter les reliques de formes animales, car selon la Bible alors prise pour rigoureusement exacte dans son intégralité, le Créateur n’avait ajouté aucune nouvelle espèce postérieurement à la Genèse, pas plus qu’il n’en avait fait disparaître, donc ces coquilles sans comparaison avec la faune actuelle ne pouvaient émaner d’êtres ayant véritablement existé, leur allure ne rappelant ainsi selon lui que fortuitement celles d’authentiques formes vivantes. Au même siècle, le spécialiste britannique des fossiles Robert Plot continue également de considérer que la majeure partie d’entre eux ne procède que de la cristallisation de sels minéraux qui aboutit parfois fortuitement à évoquer des formes biologiques.
Anciennes représentations et mystification
Johann Adam Beringer, médecin de Würzburg dans l’actuelle Bavière affecté au service du Prince de Würzburg et du Duc de Franconie ainsi que doyen de l’université de Würzburg, passionné par l’histoire naturelle, considérait encore au XVIIIème siècle les fossiles comme des œuvres divines plutôt que comme des traces d’organismes vivants, les assignant à des prototypes façonnés dans la glaise par le Créateur. Il les collectionnait dans son cabinet de curiosité personnel tels que des bélemnites, des ammonites et des dents de requins, et il avait engagé trois jeunes hommes pour qu’ils lui en ramènent depuis un gisement proche. Ses employés lui apportaient régulièrement une prolifique collecte, comportant nombre d’animaux en relief enchâssés dans des pierres dont le naturaliste s’étonnait lui-même que celles-là soient juste de la bonne dimension pour les avoir préservés dans leur totalité. Quelques-uns étaient assez fantastiques comme une sorte de larve ou de limace semblant pourvue d’une tête de mammifère à chaque extrémité ainsi qu’une créature à queue de poisson ou de homard, dotée de deux tentacules céphaliques au-dessus de ses yeux ronds et pourvue de deux petits bras humains, lui conférant une allure proche de certains extraterrestres qui seront figurés dans les magazines populaires de science-fiction des années 1930.
Représentation des "fossiles" de Beringer, dont deux spécimens particulièrement pittoresques.
Beringer publia en 1726 son ouvrage Lithographiae Wirceburgensis incluant la reproduction de 204 spécimens sur 21 planches, faisant suite à une illustration tirée des Métamorphoses d’Ovide qui dans son esprit souligne vraisemblablement le caractère surnaturel de ses trouvailles. Il faut reconnaître qu’à l’époque, la discipline que de Blainville dénommera à la fin du XIXème siècle la paléontologie (Beringer parle de lithologie, étude des pierres) n’en était qu’à ses débuts, sans parler de la taphonomie, la science qui étudie les processus de fossilisation ; les seuls restes fossiles qui apparaissent en relief sont les parties dures qui ont été minéralisées comme le bois, les squelettes et les carapaces, tandis que lorsque les contours de l’organisme sont conservés comme pour les supposés lézards et grenouilles de Beringer, ceux-ci ne se présentent que sous la forme d’une empreinte plate – l’exemple du pangolin Eomanis du site éocène de Messel en fournit une illustration remarquable, combinant le squelette intact avec la silhouette foncée qui l’entoure comme un décalque du profil de l’animal tel qu’il était à sa mort. Néanmoins, Beringer fit aussi représenter encore plus audacieusement des corps célestes qui arboraient un visage à la manière de la Lune et du Soleil dans les films volontairement naïfs de Méliès du début du Xème siècle, ainsi que des écritures hébraïques censées avoir été gravées par Dieu à la manière des Tables de la Loi remises à Moïse selon l’Ancien Testament. Il considérait ces pierres comme des sortes de brouillons laissés par le Créateur.
Quelques-unes des sculptures qu'on a fait passer pour des fossiles auprès du Professeur Johann Adam Beringer.
Contrairement à John Ray et malgré son christianisme sans faille, le médecin et naturaliste britannique John Woodward écrivit dans son Essay toward a Natural History of the Earth paru en 1695 qu’il ne faisait pour lui pas de doute que ce qu’on appelait des "pierres figurées" étaient bien d’authentiques coquillages qui vivaient autrefois dans l’eau et dont la forme avait servi de moule ou de matrice pour le sable ou d’autres matières minérales qui en ont ainsi conservé la trace, animaux qui, pour ce qui concerne les espèces dont on ne trouve pas d’équivalents actuels, ont été remontés des profondeurs à l’occasion du Déluge, ce qui explique qu’on ne les voit pas ordinairement. Son ouvrage, traduit en latin par le Suisse Johann Jakob Scheuchzer, sera diffusé dans toute la communauté scientifique. Au XIXème siècle, même si un professeur pouvait encore déclarer en 1800 que les fossiles étaient une farce divine pour tester la foi, les controverses ne mettront finalement plus en cause l’origine biologique des fossiles mais porteront toujours sur la raison pour laquelle certaines espèces étaient notablement différentes des actuelles, les créationnistes imprégnés par la Bible comme Cuvier cherchant au fur et à mesure des découvertes à établir le nombre de déluges divins qui avaient pu amener à des renouvellements radicaux de la flore et de la faune, et les évolutionnistes invoquant la transformation graduelle d’espèces au fil du temps et l’extinction de certaines d’entre elles imputables à la compétition et à des catastrophes naturelles.
Le débat enfin tranché, refermant une parenthèse de plusieurs milliers d’années durant laquelle on avait, par d’antiques croyances quelque peu exubérantes ou au nom de la religion, notamment au temps de la Renaissance sous l’égide d’un protestantisme attaché à une vision littérale de la Bible, dénié que les fossiles conservent les traits d’animaux ayant vécu dans les temps anciens, n’allait pas mettre un terme aux interprétations fantaisistes des traces animales fixées dans la pierre, comme on aura l’occasion de le constater non sans amusement dans les prochains chapitres de cette évocation.
*
Évoquons pour mémoire la disparition de quelques personnalités associées aux créatures imaginaires. L'acteur américain Michael Madsen est décédé d’un arrêt cardiaque à l'âge de 67 ans. Apparu dans de nombreux films d'action notamment de Quentin Tarantino, même s'il avait décliné le rôle de tueur à gage de son Pulp Fiction, il avait aussi interprété le héros des deux premiers films de la saga La Mutante (Species) dans le rôle de Preston Lennox, en 1995 sous la direction de Roger Donaldson, puis en 1998 dans la première suite réalisée par Peter Medak, y affrontant de terrifiants hybrides constitués d'un mélange d'ADN humain ainsi que de gènes extraterrestres, dont l'apparence avait été imaginée par le peintre suisse Hans Giger reprenant sa vision dite biomécanique qui l'avait rendu célèbre à l'occasion d'Alien, et que le studio de Steve Johnson s'était attaché à concrétiser pour l'écran. Il était aussi apparu dans le film Sauvez Willy (Free Willy) en 1993 dans le rôle de Glen Greenwood qui avec sa compagne aide leur fils adoptif à sauver une orque en captivité. Sa sœur Virginia est aussi actrice (Electric Dreams, le prologue de Dune, Candyman).
Le journaliste français Jean-Pierre Putters s'est lui éteint à 69 ans, le 10 mai 2025, soit le lendemain du décès du maquilleur Greg Cannom quatre fois oscarisé auquel l'article précédent a consacré un assez long hommage, mais on ne l'a appris que dans la seconde partie du mois de juillet, car il avait demandé à son épouse que sa disparition ne soit pas rendue publique, à l'image de l'humilité qu'il avait toujours manifestée. Débutant dans la vie professionnelle comme mitron, il consacrait le temps où il ne travaillait pas en boulangerie à lire, notamment les écrits de philosophes célèbres, ce qui contribua à structurer sa pensée pour ses analyses sur les films, sa passion du cinéma l'ayant conduit à créer un fanzine qui deviendra un magazine national réputé, Mad Movies. Les créatures monstrueuses n'étaient pas rares dans la publication - il sortira même une série de livres qui leur était dédiée, "The Craignos Monsters", et il obtint des entretiens avec de grands créateurs d'effets spéciaux, à l'exception de Rob Bottin qui répondait très rarement à la presse. Il avait en 2013 délaissé sa revue pour en créer une autre plus généraliste, "Metaluna", et semblait avoir progressivement perdu son intérêt pour le cinéma - même s'il prêtait son concours à de petits films d'horreur parodiques, pour s'adonner principalement au plaisir de jouer de la guitare et de composer des chansons.
Probablement que les films récents standardisés, à la photographie souvent sombre et laide, et rendus abstraits par leur profusion d'imagerie virtuelle avaient fini par l'éloigner de la production actuelle, et ce n'est pas le présent site qui lui donnera tort. Même si son long compagnonnage avec le cinéma de l'imaginaire avait depuis longtemps pris fin, il demeurera assurément durant encore une longue période un modèle d'autodidacte et une figure marquante et cultivée ayant défendu le cinéma fantastique de la grande époque, et il nous appartient avec des moyens certes plus modestes*, au Club des monstres de notre ami québécois Mario Giguère, qui partage avec le disparu une dilection pour l'humour au second degré (on se rappelle de la chronique de Jean-Pierre Putters qui non sans ironie relevait le détournement d'affiches pour commercialiser jaquettes ou DVD d’œuvres souvent plus obscures et sans grand rapport) ainsi qu'au blog Créatures et imagination, de poursuivre l'entreprise de ce héraut de l'imaginaire en défendant les films qui nous ont fait rêver, leurs créatures fascinantes et leurs créateurs.
*d'autant qu'après plusieurs faux espoirs, l'Histoire de l'imaginaire à l'écran proposée par l'auteur de ce blog, qui suppléerait en un volume très complet aux tomes des "Craignos Monsters" depuis longtemps épuisés, n'est toujours pas publiée - avis aux éditeurs courageux qui pourraient au moins déjà dans un premier temps le proposer en ligne aux amateurs intéressés.
*
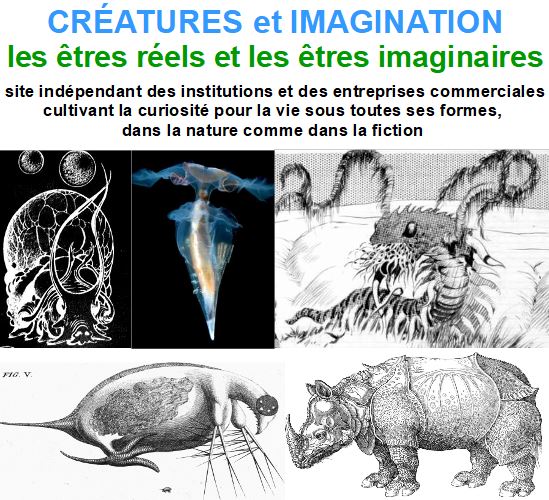







































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire