QUAND L'HISTOIRE NATURELLE SE PIQUE DE FANTAISIE, 4ème partie
Pendant une longue période de l’Histoire, on s’est fort peu préoccupé de la vie sur d’autres planètes, d’abord parce que les récits très enjolivés de voyages dans les terres lointaines et sur les océans suffisaient à alimenter l’imaginaire en créatures étranges auxquelles le célèbre chirurgien Ambroise Paré accordait encore foi, et aussi par la suite parce que la religion chrétienne postulait que le Créateur n’avait conçu qu’une seule planète au bénéfice des êtres humains et l’Inquisition jugeait hérétiques ceux qui s’aventuraient à envisager qu’il pût exister d’autres mondes en raison du silence de la Bible sur le sujet, même dans la perspective de rendre grâce aux pouvoirs infinis de Dieu comme l’infortuné Gordiano Bruno qui paya de sa vie l’intransigeance de l’Église de l’époque.

Dessin d'un télescope géant de l'astronome William Herschel, père de John Herschel.
Des cousins sur la Lune ?
Lorsque la Terre commença à être cartographiée de manière plus complète avec l’adjonction du Nouveau Monde réduisant significativement la part d’Inconnu et qu’une vision plus rigoureuse se répandit dans le domaine des connaissances, des philosophes et des astronomes se mirent à envisager théoriquement une pluralité des mondes. Cependant, bien peu s’interrogeaient réellement sur l’aspect que pourraient revêtir ces créatures susceptibles de vivre sur d’autres planètes et la fiction abordait la question essentiellement sous l’angle de l’humour, des Aventures du Baron Munchhausen au conte satirique Micromégas de Voltaire et autres facéties de Cyrano de Bergerac sur les Sélénites. Les habitants supposés de la Lune étaient vus comme plus ou moins humains et il faudra pratiquement attendre le début du XXème siècle pour que des écrivains de science-fiction commencent à répandre la conception d’extraterrestres différant réellement des espèces s’étant développées sur notre planète en faisant enfin preuve d’imagination.
Aussi, au XIXème siècle, les esprits étaient prompts à envisager la possibilité que des êtres plus ou moins semblables aux hommes puissent exister à la surface de notre satellite. En 1824, l'astronome munichois Franz von Paula Gruithisen publia "Découverte des nombreuses traces des habitants de la Lune, spécialement d'un de leurs monuments colossaux", détaillant notamment une supposée forteresse sélénite. Carl Frederich Gauss, célèbre mathématicien allemand et également directeur de l'observatoire de Göttingen, envisageait très sérieusement de disposer une centaine de miroirs de manière à correspondre avec les Lunaires.
Lorsque le directeur d’un nouveau journal lancé à New-York, The Sun, se mit en quête d’articles susceptibles de faire sensation, un de ses collaborateurs proposa une série faisant écho à ces préoccupations. Du 26 au 31 août 1835, le quotidien publia les épisodes sous le titre « Découvertes dans la Lune, faîtes au Cap de Bonne-Espérance, par Herschell fils, astronome anglais », profitant de l’absence de l’intéressé qui se trouvait effectivement en Afrique australe durant cette période. L’article initial publié le 25 août annonçait que le savant avait perfectionné son télescope, permettant une vision plus nette pour observer le sol lunaire avec beaucoup plus de précision. Et en effet, dans les jours qui suivirent, le lecteur put lire que notre satellite abritait des lacs, était couvert de végétation et d’arbres et que des animaux comparables à ceux de la Terre y paissaient, de petites licornes et des bisons. Le 28 août, un équivalent de notre espèce fit son apparition, des hommes à ailes de chauve-souris dénommés Vespertilio homo, profitant de la moindre gravité de la Lune pour évoluer dans les airs et chasser les bisons avec leurs arcs. En dépit du scepticisme de certains lecteurs, les articles furent repris par d’autres journaux et traduits en plusieurs langues. D’aucuns envisagèrent même de financer une expédition vers l’astre pour étudier ses habitants et leur apporter la Bible.

Paysage lunaire tel que la presse et de prétendus astronomes l'ont décrit.

Retranscription détaillée de l'équivalent lunaire du genre humain.
L’auteur de ce récit s’avéra être le journaliste Richard Adams Locke, qui souhaitait au travers de cette fiction se moquer des déclarations fantasques d’astronomes réputés sérieux comme les précités. Par la suite, la description de canaux sur Mars occasionnera aussi bien des spéculations avant que ceux-là ne soient imputés à de mauvaises conditions d’observation. En 1901, l’inventeur Nikola Tesla annonça à la presse avoir détecté deux ans plus tôt de possibles signaux provenant d’une autre planète ; la presse à sensation répercuta l’information en avançant qu’ils étaient émis depuis la planète Mars. Lui-même avait entrepris la construction d’une machine permettant l’envoi d’un message de la Terre à la Planète rouge. Cela a visiblement inspiré à l’humoriste Tristan Bernard une petite fable en 1920, Qu’est-ce qu’ils peuvent bien nous dire ?, qui suppose que les Martiens comprennent le français, mais l’échange tourne court lorsque les habitants de la Planète rouge répondent que c’est à ceux de Saturne qu’ils parlent.
L'existence des fées et lutins reconnue par la science ?
La perspective d’être humains ailés est revenue de manière encore plus étonnante si c’était possible par la supercherie de deux jeunes cousines Elsie Wright et Frances Griffiths ayant truqué à partir de 1917 des photographies pour faire accroire l'existence de fées à Cottingley dans le Yorkshire. Ce qui aurait pu n’être perçu que comme une manipulation enfantine a alimenté les discussions dans la presse. Si certains journaux exprimèrent sans réserve leur scepticisme comme le journal australien Truth dans son édition du 5 janvier 1921 qui n’y décela qu’une fantaisie d’enfant et l’écrivain Maurice Hewlett dans une série d’articles pour la revue littéraire John O’London Weekly, Conan Doyle, médecin et écrivain réputé pour sa création du personnage de détective à la logique imparable, Sherlock Holmes, à qui le magazine The Strand avait commandé un article pour son numéro de décembre 1920, s’enthousiasma pour ces preuves de la révélation de ces êtres extraordinaires, livrant un second texte à la même tonalité pour le périodique en mars 1921 avant de consacrer un ouvrage entier au sujet l’année suivante en y développant sa vision, The Coming of the Fairies.
L’écrivain britannique s’y montre convaincu que les êtres figurés sur les photographies ont une réalité matérielle que les fillettes sont parvenues exceptionnellement à capter. Bien que passionné par le spiritisme suite à la disparition de proches, son fils ainsi que son frère cadet, à l’instar de Victor Hugo dont la fille et le gendre s’étaient noyés, Doyle les envisage moins comme des entités surnaturelles ou des projections médiumniques sous forme d’ectoplasme dans l’esprit de l’époque, que comme évoluant dans un univers physique un peu différent coexistant à côté du nôtre, dans une séquence vibratoire différente qui se soustrait la plupart du temps à nos sens – une hypothèse théorique évoquée dans la nouvelle de Rosny aîné Le monde des variants ainsi que dans celle d’Howard Phillips Lovecraft From Beyond, adaptée au cinéma sous le même titre (en version française, Aux portes de l’au-delà) par Stuart Gordon comme évoqué dans l’hommage consacré à ce dernier. Il considère que les elfes, voire les gnomes, représentent une sorte de chaînon manquant entre le papillon et l’homme dans une conception surréaliste du darwinisme qui évoque plutôt les écrits les plus fantaisistes du début du Moyen Âge parfois empreints d’alchimie, et se montre convaincu que la science va trouver des procédés techniques permettant d’en faire de vrais sujets d’études pour l’Histoire naturelle. Il explique l’absence d’ombre par leur constitution très éthérée qui renvoie peu de luminosité. Il ajoute qu’il se représente mal comment des enfants auraient les compétences pratiques requises pour truquer des photographies et réfute comme le théosophe Edward Gardner toutes les autres explications déniant la réalité de ces petits personnages qu’on dit avoir été observés en différents lieux jusqu’en Islande, alimentant les légendes comme celle du Petit Peuple que l’écrivain Arthur Machen convoque dans ses nouvelles d’inspiration celtique.

Montage montrant le célèbre auteur britannique entouré des photos des fées.
Dans les années 1980, les deux cousines avouent finalement avoir truqué les photos, s’étonnant de la crédulité de beaucoup et précisent qu’elles s’étaient promises de garder le secret jusqu’à la disparition de Sir Arthur Conan Doyle afin de ne pas nuire à la réputation d’un homme aussi éminent. Il est d’ailleurs plaisant que les silhouettes découpées proviennent d'un livre pour enfants, Princess Mary's Gift Book, une anthologie de Claude Arthur Shepperson, dans lequel figurait une histoire de Conan Doyle lui-même, lequel aurait ainsi pu en feuilletant l’ouvrage remonter à la source de la mystification. Les cousines maintiennent cependant avoir réellement observé les fées et Frances Griffiths prétend qu’une des photos, connue comme la cinquième, est quant à elle bien authentique. En 1990, Joe Cooper a sortit un ouvrage d’enquête sur le sujet, The case of the Cottingley fairies, interrogeant les témoins toujours vivants et il en a déduit que l’affaire était effectivement un canular, sans occulter la persistance de quelques points obscurs, incluant la nature de la cinquième fameuse photo. On s’accorde à considérer que Conan Doyle s’est en cette affaire largement écarté de la rigueur attendue du médecin ainsi que du froid rationalisme analytique de son personnage iconique de détective, en se laissant séduire par l’attrait pour le Merveilleux. En 1997, deux films ont été produits sur le sujet, Le mystère des fées : une histoire vraie (Fairy Tale : A True Story) de Charles Sturridge à qui on doit aussi l’adaptation la plus complète des Voyages de Gulliver (Gulliver’s Travels) et Forever de Nick Willing qui s’en inspire plus indirectement.
L'attaque des pieuvres
Les épisodes des habitants de la Lune et des Fées de Cottingley n’ont pas pour autant amené la presse à renoncer à présenter comme réelles des fictions, jouant par la suite de l’inquiétude qui pouvait émaner d’êtres extraordinaires. Dans une nouvelle, The Raiders of the Seas, le célèbre écrivain britannique Herbert George Wells féru d’Histoire naturelle qui avait suivi les cours de Thomas Huxley, disciple de Darwin, imagine que des pieuvres de grande taille s’aventurent provisoirement hors de la mer et s’emparent de baigneuses pour les dévorer. Le récit, comme l’a révélé le cryptozoologue Michel Raynal, a par la suite donné lieu à une reprise dans le numéro du 16 décembre 1899 de Yachting Gazette, le présentant comme authentique, il fut encore considéré comme tel par le navigateur Alain Grée dans le numéro de mars 1978 de Voiles et voiliers puis par Dominique Chartrain et le cryptozoologue Jean-Jacques Barloy dans le mensuel Océans d’octobre 1979. L’auteur de l’article initial dans Yachting Gazette n’avait pas occulté le récit de Wells mais par un audacieux retournement présentait celui-là comme ayant inspiré la fiction de l’écrivain britannique, et ce dernier avait lui-même initialement mêlé fiction et réalité dans son texte puisqu’il associait dans le corps de son histoire un épisode véritable relatant la récolte le 18 juillet 1895 au large des Açores par l'expédition océanographique du Prince Albert 1er de Monaco de spécimens de céphalopodes géants régurgités dans son agonie par un malheureux cachalot qui avait été harponné par une équipe de baleiniers portugais.
Depuis le Kraken mythique, la peur irraisonnée que suscitent les céphalopodes géants n’a pas cessé d’alimenter les imaginations ; en 2016, le sculpteur Joseph Reginella a érigé au Sud de l’Île de Manhattan un monument en hommage aux passagers d’un paquebot, victimes imaginaires de l’attaque d’une pieuvre colossale, en plus d’un site internet, de faux articles dans la presse, et de la présence prétendue dans le centre culturel du port de fragments d’épaves portant des marques de ventouses géantes, l’ignorance de la tragédie alléguée étant justifiée par l’assassinat du Président John F. Kennedy le même jour. Par ailleurs, l’écrivain Lyle Zapato a propagé en 1998 sur internet la fausse rumeur d’une pieuvre amphibie nommée Octopus paxarbolis (littéralement la pieuvre des arbres du Pacifique) capable de coloniser les rivières et même susceptible d’être aperçue dans les frondaisons de l’Olympic National Forest de l’État de Washington, en attirant l’attention sur le risque d’extinction pour cette espèce particulière dont raffolerait le légendaire Bigfoot, le site trompant la majorité des élèves des écoles auxquels on propose de tester sa crédibilité – par la suite, le paléontologue Dougal Dixon a imaginé dans le cadre d’un avenir potentiel dont les humains auraient disparu pour la série spéculative en images de synthèse Sauvage sera le futur (The Future is wild) de 2002 une pieuvre arboricole, le squibbon.
D’autres êtres à allure de céphalopodes inventés par l’écrivain anglais, ses Martiens de La Guerre des mondes (The War of the Worlds), donnèrent lieu à un feuilleton radiophonique par son homonyme Orson Welles, qui aurait suscité quelque inquiétude parmi les auditeurs prenant l’émission en cours qui crurent assister à un reportage en direct en dépit de la présentation régulière du programme avant chaque diffusion de l’émission, même s’il semble que la panique ait été exagérée rétrospectivement, peut-être même par l’intéressé qui cherchait à se faire connaître.
Des plantes tout aussi inquiétantes
De la même manière que les pieuvres aventureuses de Wells, parut en 1874 dans le New-York Times un article d’Edmund Spencer relatant une lettre d’un prétendu explorateur allemand qui dépeignait une plante carnivore géante à laquelle des Malgaches offraient des vierges, enserrant les victimes dans ses longues feuilles mobiles. Le récit eut l’honneur de la couverture du numéro 61 du Journal des voyages en 1878 et fut repris dans nombre d’autres journaux. En 1924, le gouverneur du Michigan Chase Osborn fit paraître un ouvrage sur le sujet, Madagascar, Land of the Man-eating Tree, consacré aux légendes de l’Île, assurant que les indigènes comme les missionnaires connaissaient bien cette histoire, tout en précisant qu’il ne pouvait lui-même déduire si cet arbre effroyable existait réellement ou bien s’il ne ressortissait que d’un mythe. En 1955, le zoologiste Willy Ley établit dans son essai Salamanders and Other Wonders que le terrifiant végétal n’existait pas davantage que la tribu des Mkodo à laquelle était attribué ce rite sacrificiel.
Ce ne fut pas le seul exemple de plante anthropophage inventée à laquelle la presse conféra une aura de réalité. En 1889, un journal publia un article se référant à « un naturaliste bien connu de la Nouvelle-Orléans » du nom de Duncan qui narrait avoir trouvé, alors qu’il collectait des spécimens de plantes et d’insectes dans un marais d’Amérique centrale, son chien agonisant enserré dans un étroit réseau fin comme de la corde de fibres et de racines. Les indigènes qu’il employait lui indiquèrent que cette espèce de vigne était appelée « le piège du Diable ». Il s’en tint à l’écart par crainte que le végétal ne lui arrachât la peau et même les chairs, mais releva qu’il était doté d’un nombre infini de minuscules ouvertures ou ventouses capables de sucer le sang de sa proie avant de relâcher la carcasse exsangue. Une version plus courte de l’histoire reparut en septembre 1891 dans Lucifer, le journal de la mystique Helena Blavatsky, traitant de sujets religieux, philosophiques et scientifiques, avant que l’éditeur de Review of the Reviews, William Thomas Stead n’y fasse paraître un court article en octobre 1891 mettant fortement en doute ce récit.
Enfin, la chaîne britannique Panorama monta pour le 1er avril 1957 un reportage de trois minutes sur une famille suisse effectuant une récolte auprès d’un "arbre à spaghettis" et un certain nombre de spectateurs s’enquirent auprès de la respectable BBC concurrente de la manière dont ils pourraient à leur tour faire pousser des arbres à spaghettis, à une époque où cet aliment était encore peu connu Outre-Manche.
On voit donc comment, bien avant les "fausses informations" dispensées sur internet, des journaux n’ont pas hésité à diffuser des faits inventés en rapport avec l’Histoire naturelle, même si ces affabulations ne paraissaient pas toujours complètement farfelues aux lecteurs de l’époque. Il existe bien dans l'Océan Pacifique des pieuvres géantes, inoffensives pour le plongeur (Enteroctopus dofleini), et par ailleurs, diverses espèces animales prédatrices s’attaquent au moins occasionnellement à l’homme ; quant aux plantes anthropophages censées exister au sein de la flore tropicale luxuriante, elles n’étaient finalement que l’extrapolation à plus grande échelle de véritables végétaux qui piègent insectes et d'autres petits animaux tels que des mammifères, désignées collectivement sous le nom de plantes carnivores, la possibilité théorique que certaines encore inconnues des Occidentaux soient en mesure de s’emparer de plus grandes proies incluant l’espèce humaine étant combinée avec l’évocation de rites cruels qui existèrent dans nombre de tribus et civilisations. Il est vrai que ces canulars de presse destinés à éveiller l’imagination des lecteurs n’émanaient pas directement de savants, mais il existe néanmoins quelque lien puisqu’on les associait à de supposés naturalistes dans les cas des végétaux anthropophages, l’histoire de l’arbre malgache étant même reprise dans une revue semi-scientifique, on en créditait un astronome réel dans le cas des hommes lunaires volants, l’intéressé s’amusant de cette fantaisie et la relativisant plutôt que de s’en offusquer par un véhément démenti avant de tardivement publier un communiqué qui passa plutôt inaperçu, quant aux fées, elles ont reçu l’onction du médecin Conan Doyle, et l’ornithologue professionnel Jean-Jacques Barloy a accordé foi aux attaques de poulpes, sur la base des articles les relatant sans suspecter leur caractère factice. Dans la prochaine partie de cette série d’articles consacrée à la fantaisie dans l’Histoire naturelle, on portera notre attention sur les espèces animales relevant d’une zoologie fantasmagorique.
Lien de la Fondation Brigitte Bardot pour aider les animaux :
http://www.fondationbrigittebardot.fr/
ATTENTION, ALERTE ! On rapporte que des escrocs adressent des messages pour solliciter de l'argent au nom de Brigitte Bardot. Ne faîtes des dons que sur le site officiel de la Fondation.
PS : n'oubliez pas de cliquer tous les jours sur les différents liens de ces deux sites pour aider d'autres animaux dans le besoin :
http://www.animalwebaction.com/fr/
***
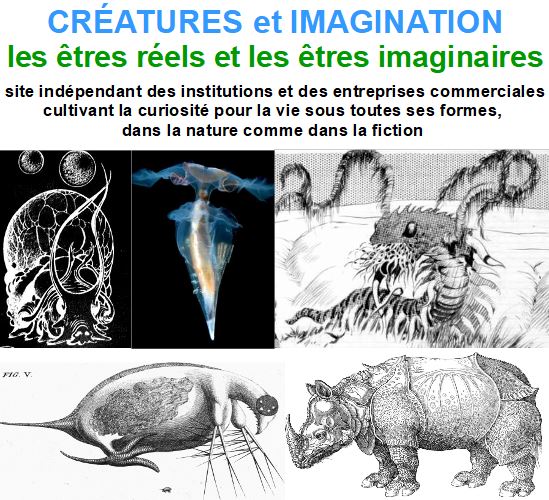



.webp)




_1.jpg)


















.webp)

_Hydraulic_Engineer_recadr%C3%A9.jpg)





















